À VOIR : Le clip "Fuck Mes Rêves" de S-Pion et N.O.S., avec le chimpanzé de QLF

Si le nom de Jérôme Hadey vous échappe, les noms suivants devraient en revanche vous dire quelque chose : RZA, Vin Diesel, Amy Winehouse, Mathieu Kassovitz, George Clinton, Irfane… Depuis la fin des années 90, ce passionné de musique a tracé une route invraisemblable qui l'a amené des studios d'Hollywood à ceux de Hans Zimmer, du Quai d’Orsay aux vignobles de Toscane. Serge Le Mytho rêve d'avoir la vie de Jérôme. Il est devenu successivement régisseur du Wu-Tang Clan, assistant de Pedro Winter époque Daft Punk, collaborateur du Ministre des Affaires étrangères Philippe Douste-Blazy, gérant de la Villa Lena ou encore assistant personnel de Vin Diesel. Après avoir pris ses distances avec la musique pendant huit ans, Jérôme revient aujourd’hui avec un premier EP en solo, Never For Money Always For Love, qui sera suivi d’un album à la rentrée. Sa carrière est (vraiment) incroyable.Clique : Par où commencer ? Jérôme, tu as eu mille vies… Jérôme Hadey : Oui. Et c’est pas fini, je continue, effectivement. C’est un truc que tu cultives ça, le fait de changer de vie, régulièrement ? C’est bizarre, les vies… Je ne sais pas. J’ai toujours eu des opportunités hallucinantes et je les ai saisies. Elles m’ont fait passer de Hollywood au Quai d’Orsay en passant par le monde de la musique mais c’est surtout des rencontres humaines. J’ai eu la chance de rencontrer des gens qui m’ont embarqué dans des projets passionnants. Et je suis passé d’un projet à l’autre sans jamais m’arrêter. Mais le fil conducteur, ça a toujours été la musique.
La musique, c’est la seule constante que j’ai eue dans toute ma vie et autour de ça, j’ai brodé plein de choses. C’est la musique qui m’a mené au cinéma.Bizarrement, c’est la musique qui m’a amené au Quai d’Orsay pendant un an et demi. C’est la musique qui m’a mené à Londres, qui m’a fait monter mon projet de fondation en Toscane. C’est plusieurs facettes d’une même pièce musicale, en quelque sorte. Qui commence sur les bancs de l’école avec Irfane, le chanteur binôme de Breakbot, et le graffeur Jay1 ? Jay1 est un peu plus vieux que moi, mais Irfane et moi, nous nous sommes connus à l’école à Strasbourg, quand on était très jeunes. Nous avons commencé ensemble à faire les DJ et à produire de la musique. Là, on est entre 1990 et 1995. Jay1, lui, graffait déjà dans les années 80. L’histoire, c’est que Jay, c’était un peu notre idole du graffiti. Il était dans le crew BBC de Paris et nous, à Strasbourg, on avait un collectif qui s’appelait Rising Suns où on faisait du DJing, du break, du graffiti, et du rap, tous les éléments du Hip-hop.
Irfane est le chanteur de "Baby I'm Yours" avec Breakbot.
On organisait notre festival, Summer Session, tous les ans à Strasbourg près de la frontière franco-allemande, on a invité Jay et ça a cliqué. Donc, avec Irfane et Jay, on s’est lancés dans l’aventure Outlines ensemble, un groupe de musique qui comprenait la musique et le visuel. C’était vers la fin du lycée, et Rising Suns a fêté ses vingt ans cette année.Comment sont nées les Summer Sessions ? J’ai monté ça avec mon petit frère Philippe et une vingtaine de jeunes franco-allemands. Ce qui s’est passé, c’est qu’aux alentours de 96-97, il y avait plus de mille voitures qui avaient cramé au Nouvel An à Strasbourg. Il y avait une grosse urgence sociale. La région a mis plein d’argent dans les cultures urbaines. Je crois qu’on appelle ça comme ça, encore aujourd’hui ? (sourire) Et ils nous ont proposé un gros chèque pour organiser un festival. On avait 17 ans et forcément, on a accueilli ça avec plein de joie. On s’est retrouvés à faire un festival un peu communiste dans la mesure où on a fait venir près de deux cents artistes de France, d’Allemagne, d’Italie, des États-Unis, et de toute l’Europe. L’idée, c’était de répartir tous les revenus à parts égales entre les artistes. On a fait venir IAM, pas mal de rappeurs marseillais, Assassin, des gens du Bhoutan, des breakeurs assez exceptionnels, des graffeurs du monde entier et ça a duré cinq-six ans. On a fait ça tous les étés. C’est là qu’a vraiment commencé mon premier gros projet dans lequel je m’étais lancé avec mes copains et qui a donné naissance à plein de petits bébés.

L'affiche de l'édition 2002 du festival Summer Session.
Comment avez-vous commencé à produire de la musique avec Irfane ? À ce moment-là, Irfane était parti faire ses études aux États-Unis, à Philadelphie. Il était rentré à Paris pour faire du consulting, un truc atroce, et donc, au bout de quinze jours, il s’est mis en arrêt maladie et à la place de bosser dans son stage, on a fait de la musique. Il a squatté dans mon appartement ; je venais de bouger à Paris pour faire mes études et on a fait de la musique ensemble. Il y a un des titres qu’on avait produits qui a tourné sur Mini-Disc, pour ceux qui se souviennent de ce format… Mais, surtout, un DJ anglais qui s’appelle Gilles Peterson a commencé à beaucoup jouer ce titre sans qu’on soit au courant. En même temps, moi je faisais un stage chez Ed Banger, qui s’écrivait encore “H e a d” à l’époque. À ce moment-là, Pedro s’occupait du management des Daft Punk, Cassius, DJ Mehdi et Cosmo Vitelli. C’était avant les débuts du label donc je bosse chez Pedro, on fait de la musique avec Irfane, et on a ce DJ londonien qui joue notre titre toute la journée à Londres… On se retrouve à signer avec un label berlinois, qui s’appelle Sonar Kollektiv, qui était le label du groupe Jazzanova - qui se trouve parmi nos héros aussi. Jazzanova fera d’ailleurs un remix pour vous en 2006... Voilà. Et Dixon aussi a fait un edit. Dixon, avec qui on vendait des petits pains à Berlin dans sa sandwicherie vers 2002 avant qu’il devienne le DJ numéro 1 au monde (rires). On jouait au foot tous les dimanches avec lui et son équipe de foot. On a enregistré notre premier album à Berlin. Donc, là on est en 2002 et toi tu fais un stage de deux ans chez Ed Banger ? Oui. C’était trois mois qui se sont transformés en deux ans. C’était Pedro qui s’occupait de ça. Et moi je l’assistais, notamment sur les Daft Punk. C’était à l’époque de toute la série du deuxième album et toutes les vidéos qui sortaient avec le réalisateur d’Albator, Leiji Matsumoto. C’était aussi les tous débuts de la pyramide quand ils sont commencé à faire leur show… Et comment tu es venu toquer à la porte d’Ed Banger ? C’est triangulaire. Je connaissais bien le Saïan Supa Crew, qui était venu à Strasbourg pour mon festival. Leur directeur artistique est un ami qui s’appelle Jan Ghazi, qui connaissait bien Pedro ; moi je cherchais un stage, Pedro cherchait un stagiaire, Jan Ghazi nous a présentés. À l’époque j’étais Hip-hop à fond. C’est Pedro qui m’a fait découvrir la musique électronique. J’en avais absolument rien à foutre de la musique électronique. C’était un monde obscur pour moi. Et je crois que Pedro cherchait quelqu’un passionné de musique mais pas trop fan de musique électronique justement. Donc, on a connecté comme ça. Tu as quel âge à ce moment-là ? Là, 22. Et aujourd’hui, tu as quel âge ? 38. Donc est en 2002 et à ce moment-là, il y a même Irfane qui commence à faire de la prod pour des rappeurs américains underground comme Shabazz et The Arsonists… Oui. Ça aussi c’était de bons amis. Eux étaient venus régulièrement à Strasbourg. Shabazz, c’était même bien avant ça. Pour tout te dire, Shabazz, c’est notre première session de studio et ça doit dater de 1997 à peu près. Et avant, ce que j’ai oublié de raconter, c’est que, pendant mes festivals en Allemagne, j’ai des amis rappeurs de Stuttgart qui avaient bien marché. Oui, il faut que je passe par là aussi, parce que, avant Pedro, j’avais des amis rappeurs de Stuttgart, Massive Töne, qui avaient cartonné. J’avais bossé avec eux sur leur album et d’un coup, ils s’étaient retrouvé à monter leur label. Alors, on avait lancé le label avec eux, Irfane était dans l’aventure aussi mais c’était surtout moi. Pour l’anecdote, leur premier album s’appelait Kopfnicker, ce qui veut dire en allemand « head banger ». Et donc je me suis retrouvé à monter ce label avec eux. Là, j’ai fait une compil de rappeurs franco-allemands qui s’appelait French Connection.C’est un truc un peu obscur, avec que des collaborations franco-allemandes. Chaque fois, un rappeur français avec un rappeur allemand. Ça n’a pas fait énormément de bruit mais c’était un projet passion. Derrière, vu le tracklist que j’avais sur l’album, je reçois un coup de fil de la manageuse de RZA du Wu-Tang qui m’appelle et me dit : “écoute, RZA veut faire un album avec des rappeurs européens mais le label avec qui on bosse – c’était Warner – n’arrive même pas à contacter ses propres rappeurs. Toi, sur tes albums, tu as tous les gens avec qui on veut bosser, tu peux nous aider à faire la prod de l’album ?” Et donc, j’ai accepté, c’était en 2000. Je pensais que c’était une blague au début. J’ai dit oui et trois semaines après, je me retrouve avec RZA à faire le tour de l’Europe et à enregistrer des morceaux avec tous les rappeurs européens.

The World According to RZA, le projet sur lequel Jérôme a travaillé.
RZA, j’ai passé deux mois avec lui et c’est à ce moment-là où je me suis dit que le rap allemand – dans lequel j’étais impliqué et qui était devenu ma vie professionnelle – avait ses limites et que je n’allais pas y passer ma vie. Je touchais déjà un cachet assez important, mais RZA m’a proposé de doubler mon cachet si j’allais faire des cours à l’école.Et donc, je suis allé faire une école de commerce à Paris et c’est RZA qui a payé toutes mes études. Mes factures étaient envoyées à Wu-Tang Corp à New York et ils recevaient des chèques signés par RZA. Et personne n’en avait rien à foutre sauf moi. Et donc, RZA a payé mes études il y a dix-huit ans de ça maintenant.
Incroyable ! Et depuis, on est restés très proches. Aujourd’hui, c’est le parrain de mon fils. C’est un de mes meilleurs amis. On se voit deux à trois fois par an. J’ai quelques problèmes de santé là, et il est venu deux fois de Los Angeles me voir, pour me soutenir. Donc voilà. Pour reprendre : on a donc commencé avec le festival, ensuite, la belle époque allemande, ensuite le projet avec RZA, ensuite retour à l’école et « Head Bangers ». Là, on est à peu près en 2003-2004. J’ai lu que tu avais aussi été manager de tournée pour le Wu-Tang Clan... Oui. Ça, je l’ai fait un peu plus tard. J’ai fait une tournée en Europe avec eux, on a fait 27 dates en 32 jours. C’était sans aucun doute la plus dure expérience professionnelle de ma vie, mais on a réussi toutes les dates… Avec ou sans ODB ? Sans ODB, mais tout le monde était là sinon. Ça devait être en 2007, je pense, ou 2008. Reprenons les choses dans l’ordre. En 2005, avec Outlines, vous sortez votre premier EP. On dit souvent que Outlines c’est un duo mais en fait c’est un trio : il y a toi et Irfane à la prod et en fait, Jay1 fait vos pochettes. Voilà, le visuel et les clips. En fait, on a vraiment abordé ça comme un projet artistique dans son ensemble, comme dans le Hip-hop de l’époque où on avait déjà l’habitude des jams avec un type qui breakait, un type qui faisait de la musique, et un autre qui faisait du graffiti en même temps… On voulait vraiment réunir la musique et les visuels dans un projet commun. Outlines, c’était ça. En 2007, vous sortez votre premier album qui s’appelle Our lives are too short. Est-ce que tu penses vraiment que notre vie est trop courte et que c’est pour ça que tu la vis à cent à l’heure ? Oui, probablement. J’ai peut-être un peu trop poussé au premier degré le titre de l’album. (rires) Sur ce projet, il y a déjà un premier featuring avec RZA (qui sera suivi en 2011 par un remix de RZA de votre morceau “Visions”), et aussi ce double remix de DJ Medhi, où vous remixez “Lucky Boy” mais aussi “Lucky Girl”... Oui, c’était toute la collection Ed Banger de Mehdi. On était très proches de lui. C’était la meilleure collection qu’on a faite, je pense. Comment s’est fait ce remix avec DJ Mehdi ? C’est Pedro ou Medhi qui nous ont donné les pistes et nous ont demandé de faire un remix. Irfane habitait dans une des grosses tours de Clignancourt, dans l’un des derniers étages. On s’est mis dans l’appartement, on a fait ça en une ou deux nuits. Et je sais qu’il lui plaisait beaucoup, le remix.

Le EP "Lucky Girl" de DJ Mehdi, sur lequel figure le remix de Outlines.
Sur vos albums, il y a d’ailleurs des “Clignancourt edit” ? Oui, justement à cause de la tour de Clignancourt. On a passé beaucoup de temps dans cette tour à crack. Ce qui était chiant, c’était qu’à l’époque, on mixait beaucoup sur vinyle encore. C’était les débuts du mix avec CD. Bref, je crois qu’Irfane habitait au dix-huitième étage, un truc comme ça. Et l’ascenseur ne marchait pas une fois sur trois. Ce qui fait que tu rentrais à quatre heures du mat’ avec tes vinyles qui pesaient une tonne et là, il fallait se taper tes dix-huit étages de la crack tower, à marcher au-dessus des mecs avec leurs seringues, dans les escaliers. Ça ne me manque pas trop, ça. (rires) Mais j’en garde plein de bons souvenirs. Irfane a dû passer cinq ans au moins, là-bas. Mais il y avait une vue sur tout Paris, c’était incroyable. Une fois que tu étais dans l’appartement, c’était magique. Le problème, c’était d’y accéder. (rires)L'album 'Our Lives Are Too Short' de Outlines
Et c’est au même moment que tu t’occupes de faire une tournée avec le Wu-Tang ? Oui, c’est RZA qui m’a demandé parce que son manager avait lâché le truc. Pourquoi ?Parce qu’il faut être un peu fou pour faire tour manager du Wu-Tang, je m’en suis rendu compte après. C’était génial comme expérience, mais c’était super fatigant parce qu’il faut se rendre compte qu’ils étaient huit gars du Wu-Tang, plus leurs cousins, leurs copains, leurs machins.Donc on parle d’une trentaine de personnes. Sauf qu’il n’y avait que RZA, GZA et Method Man dont les portables fonctionnaient à l’étranger. En plus de ça, ils étaient tous uniquement à l’heure new-yorkaise, donc l’heure locale on s’en foutait, il fallait donner l’heure de New York pour leur entrée sur scène. Ils ne voulaient être payés qu’en dollars : ils n’acceptaient aucune monnaie puisqu’ils ne comprenaient pas les autres monnaies. Après, honnêtement, je n’ai pas eu de problème. Ils étaient adorables, super professionnels, hyper respectueux. Bon, quand il y avait un ou deux gars qui ne voulaient pas nous payer, ils montraient clairement d’où ils venaient mais ça s’est super bien passé dans l’ensemble. Mais quand tu es seul à t’occuper de trente personnes et qu’il n’y en a pas un qui a un téléphone portable à joindre, c’est l’enfer. En fait, tu étais leur nounou ? Ah oui, j’étais la nounou, la baby-sitter, l’assistant… C’était vraiment intense et j’étais seul à gérer tout le bordel. Au départ, il y avait deux personnes qui produisaient la tournée mais ils avaient jeté l’éponge et s’étaient barrés. C’était vraiment moi, le clan et leurs cousins. Et en plus, c’était une tournée qui s’était organisée en dernière minute, donc il n’y avait pas de tour bus. On devait prendre un avion tous les jours. On n’a pas raté un seul vol, on n’a pas été en retard pour un seul concert. Une des meilleures anecdotes, c’est qu’on avait un énorme concert en Suisse. À peu près 100 000 personnes. Festival de trois-quatre jours et Wu-Tang Clan c’est le dernier concert du dernier jour sur la scène principale. Juste avant, il y a les Red Hot Chili Peppers et sur l’autre scène, il y a Ice Cube. Et ensuite, le Wu-Tang. Le problème, c’est que le Wu-Tang devait encore toucher 100 000 dollars en cash pour faire le concert. Mais les organisateurs ne veulent pas payer le Wu-Tang avant qu’ils soient montés sur scène. Et le Wu-Tang ne veut pas monter sur scène avant qu’ils aient leurs 100 000 dollars… Donc, commencent deux à trois heures de négociations entre les organisateurs et le Wu-Tang. On arrive à un compromis : ils vont me donner le cash quand ils sont sur scène. Donc là, il y a le public des Red Hot Chili Peppers et celui de Ice Cube qui convergent ensemble vers la scène principale. Tout le monde attend. Le Wu-Tang monte sur scène, RZA prend le micro et dit : “Jérôme, va chercher l’argent.” On est tous sur scène. Les organisateurs ne sont pas prêts du tout, ils pensaient que ça serait après la performance… Donc, j’ai dû aller sous la scène compter 100 000 dollars en cash, sachant que le plus gros billet c’était 100 dollars. J’ai dû compter mille billets de 100 dollars sous la scène, les mettre dans mon pantalon, monter sur la scène, leur montrer. Ça a duré vingt minutes.
Pendant ce temps, il y avait 100 000 personnes qui criaient “Wu-Tang, Wu-Tang !”, les gens devenaient fous ! Et j’ai dû monter sur scène, remonter mon t-shirt et montrer que j’avais leur argent scotché autour du ventre… et ils ont commencé à jouer.Ils ont joué quoi comme premier morceau ? C’était « Wu-Tang Clan Ain't Nothin’ To Fuck With ».
Le clip de Wu-Tang Clan Ain't Nothin’ To Fuck With du Wu-Tang Clan
Tu as d’autres anecdotes ? Après, il y en a d’autres mais je ne sais pas si je peux les partager en public. Je les garde peut-être pour mes mémoires. (rires) Non, les gars étaient adorables, ils étaient cools. Ah ! Si, par exemple, à Amsterdam. À Amsterdam, on se retrouve en backstage pour le concert, et il y a un mec qui veut être gentil avec Method Man parce qu’il fume de la weed, il lui donne la plus grosse quantité de weed que j’ai vue de ma vie, c’est-à-dire qu’il lance sur Method Man un truc de la taille d’un coussin. Il devait y avoir 4 ou 5 kilos de weed. Un truc énormissime, et il lance ça à Method Man, alors qu’on ne restait pas plus de quatre heures à Amsterdam. Et Method Man, il regarde le truc, et me le jette dessus. Je me retrouve avec ce coussin énorme rempli de weed et là je pense que même à Amsterdam, c’est illégal de transporter un truc comme ça. (rires) “Jérôme, garde-moi ça”. Alors j’ai dû organiser un sac de sport pour garder je ne sais pas combien de kilos de weed à Amsterdam. Il est devenu quoi ce sac ? Franchement je ne sais pas, mais je pense que la weed devait être bonne (rires). Après je faisais attention, j’interdisais à tout le monde de prendre quoi que ce soit dans l’avion. Ça c’était un gros débat avant le départ, mais les mecs ne prenaient rien. De toute façon, quand tu es le Wu-Tang, j’imagine que peu importe où les mecs mettent les pieds, il y a toujours un mec avec de l’herbe pour les rencontrer... Oui, pour les gens, c’était un peu le cadeau d’accueil. Et il n’y a jamais eu un mec pour leur offrir autre chose ? Non, je pense que c’est surtout de la weed et peut-être du whisky, des belles bouteilles. Le champagne aussi, ils sont coquets, ils aiment bien leur Dom Pérignon. Ils s’y connaissent en champagne, j’étais assez surpris. Ils font la différence. (rires)Jerome Hadey - There is a Moment.
Tu étais tour manager, mais tu n’avais pas du tout appris à l’être. Comment tu t’es débrouillé ? Tu t’es formé sur le tas ? On m’a donné un conseil quand j’étais petit. Quand j’ai monté mon label de Hip-hop allemand avec mes potes, un des fondateurs de la concession m’a dit : “sois honnête et fais du mieux que tu peux”. J’ai toujours gardé cette devise et ça, avec un petit peu de bon sens et de logique, ça suffit. Après, mon père – pour répondre à la question du tour manager – était agent de voyage donc j’ai grandi dans un univers du voyage, déjà. J’avais un peu l’habitude d’accompagner des groupes dans des voyages depuis que j’étais tout petit et après, pendant les années Ed Banger, j’ai souvent accompagné Medhi pour des dates par exemple, ou avec les Daft quand il n’y avait pas de tour manager de disponible. Donc j’avais fait, on peut dire, mes classes de tour manager chez Ed Banger. Tu viens de Strasbourg. Ils faisaient quoi tes parents ? Ma mère était institutrice et mon père avait une agence de voyage. Ce qui m’a permis de voyager beaucoup quand j’étais petit. J’ai lu dans une interview qu’il y a un bouquin que tu lis souvent et qui est un peu ton livre de chevet, dans lequel tu trouves souvent les réponses aux questions que tu te poses. Ce bouquin c’est le Petit Prince. Ben là, je le lis à mon fils maintenant. Beaucoup. Pourquoi ce livre ? En fait, j’ai dû l’apprendre par cœur quand j’avais huit ans, à peu près. On devait apprendre une page par jour. Et j’ai eu la chance d’avoir une enfance très heureuse, on n’était pas particulièrement riches, loin de là, mais on ne manquait de rien et j’étais vraiment heureux. Une enfance simple et heureuse.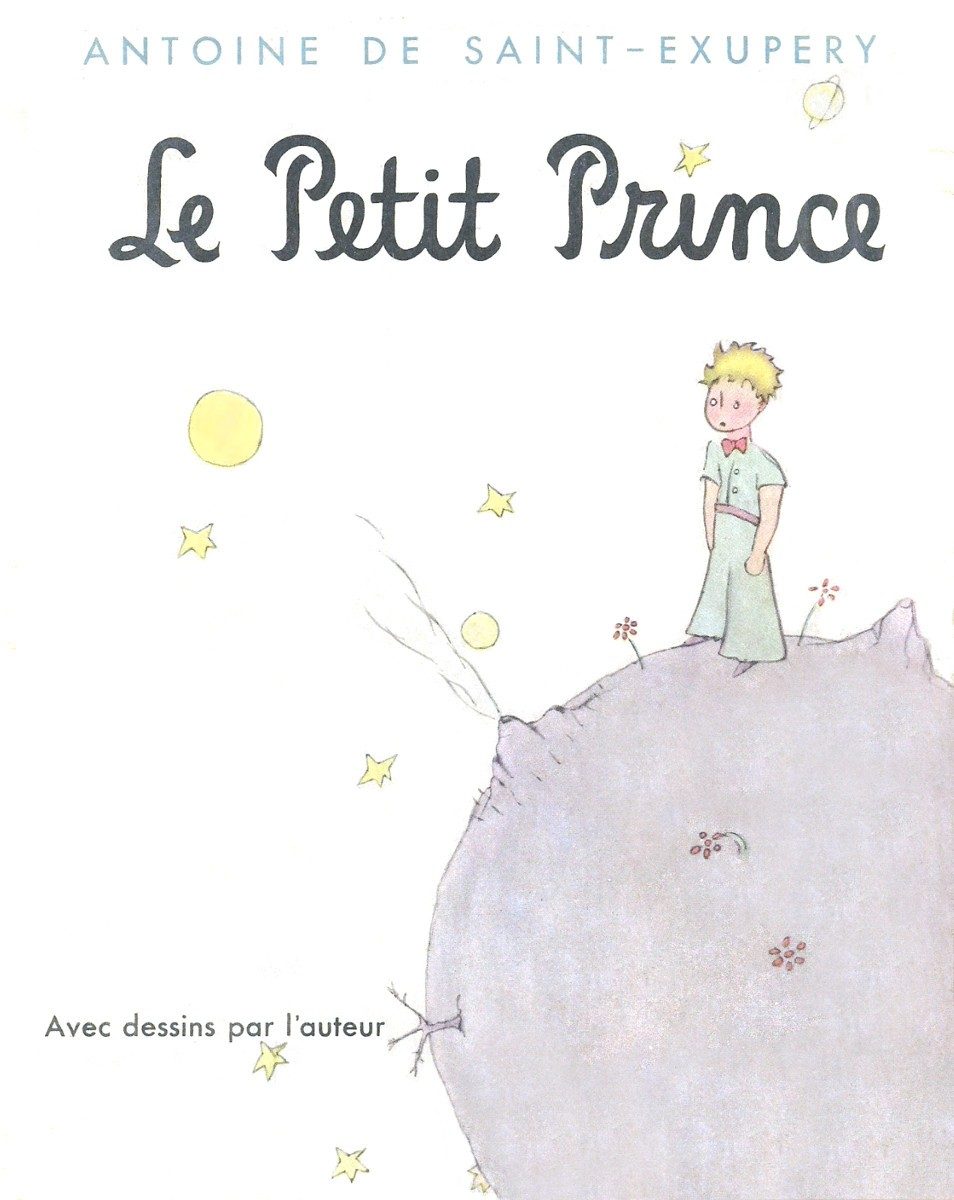 Le contenu du livre me renvoie à cette période de ma vie, où j’étais simplement heureux avec des choses très simples. Et ça me rappelle le fait qu’on n’a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Et c’est pour ça que j’ai aussi beaucoup changé de choses et que j’ai avancé.
Le contenu du livre me renvoie à cette période de ma vie, où j’étais simplement heureux avec des choses très simples. Et ça me rappelle le fait qu’on n’a pas besoin de grand-chose pour être heureux. Et c’est pour ça que j’ai aussi beaucoup changé de choses et que j’ai avancé.
Comment dire, le succès ou la notoriété, ou même l’argent, ça n’a jamais été des motivations pour moi, parce que je me souviens toujours que sans avoir eu ça, j’étais très heureux.C’est le titre d’un morceau du dernier projet que tu viens de sortir : “Rien pour l’argent, tout pour l’amour”... C’est ça. Les gens les plus tristes que je connais sont très riches. Enfin, la pauvreté, il n’y a rien de plus triste, La misère c’est la misère, la pauvreté il n’y a rien de plus dur. Il y a des gens qui vivent dans la misère, qui souffrent. Mais il y a des gens riches que j’ai rencontrés qui étaient bien souvent très malheureux et tristes. C’est quelque chose que j’ai compris assez tôt dans ma vie. Plutôt que de courir derrière l’argent ou me forcer à faire quelque chose contre ma volonté ou mes passions, je décidais à chaque fois – ça fait cliché… – de suivre mon cœur, mes envies quelles qu’elles soient, et c’est comme ça que j’ai avancé. Tu te souviens du premier morceau que tu as composé ? Tu as appris à jouer d’un instrument ? Non. J’avais un piano dans ma chambre, mais je n’ai jamais vraiment appris à jouer d’un instrument. En premier c’était des boucles, du sample. On a été bercés à DJ Premier, au Wu-Tang et aux standards de Soul. Mes premiers instrus, c’était Nina Simone, Al Green et compagnie. Je cherchais dans les disques de mes parents ou des brocantes et on faisait du sample. Et on faisait du boom bap avec la rythmique et des boucles. Même au début, avant la MPC, on avait une table, une mixette Gemini où il y avait un sampleur où tu pouvais mettre une boucle. Donc ce qu’on faisait avec Irfane, c’est qu’on prenait un sample de jazz ou de soul, on le mettait dans la mixette et après on avait des vinyles de breakbeat. On les ralentissait parce que c’était trop rapide, c’était la vitesse pour breaker. Donc on ralentissait les vinyles, on mettait un sample sur la mixette et on enregistrait sur le lecteur cassette. Et après, on faisait croire à tout le monde que c’était des mixtapes qui venaient de New York. (rires) Vous les vendiez ? Non, non, on n’a pas poussé le vice jusque-là (rires). Les gens nous ont crus un petit moment, mais ça n’a pas marché très longtemps. Sur votre premier album, il y a un featuring de RZA. Comment ça s’est enregistré ? C’était déjà un bon ami ? Non, à l’époque on restait juste en contact. Je l’avais vu à Los Angeles, une ou deux fois. Quand le Wu-Tang venait en tournée en Europe, je m’arrangeais toujours pour aller les voir, sur une date, je gardais le contact comme ça. Et là ce featuring, il s’est fait pendant un concert de RZA à Reims où on est allés le rejoindre à l’hôtel et on a enregistré dans sa chambre, après le concert. Bien arrosé. Au même moment, j’ai travaillé une ou deux années avec le réalisateur/directeur artistique Thibaut de Longeville, où on a fait la B.O. de son documentaire Just for kicks (le culte des sneakers) (il s’agit du premier documentaire officiel consacré à l’importance des sneakers dans la culture populaire. Très impliqué dans le rap français de la fin des années 90, Thibaut est également l’un des co-fondateurs du tournoi de streetball Quai 54, NDLR). Ensuite, je me suis retrouvé à bosser avec Vin Diesel pendant un an.
Le trailer du documentaire Just for Kicks.
Comment tu t’es retrouvé à bosser avec Thibaut de Longeville ? J’ai travaillé avec Thibaut parce qu’il bossait avec Tex « Texaco » Lacroix. C’était le roi de la promo Hip-hop en France et moi, j’étais à Strasbourg où je faisais la promo pour tous les labels Hip-hop.En gros, je collais des stickers et je recevais des vinyles gratuitement. J’avais seize ans et j’adorais ça.C’est Texaco qui m’envoyait les vinyles et les stickers. Il était associé avec Thibaut chez la boite 360 et c’est comme ça qu’il m’a présenté Thibaut. Et tu t’es retrouvé à faire la B.O. d’un docu sur les sneakers ? Voilà, la production exécutive. C’était génial, je faisais des allers-retours entre Londres et Paris et j'interviewais des gens. J’étais un peu l’assistant de Thibaut sur tout le projet. Après, je voulais un titre un peu plus prestigieux qu’assistant du réalisateur. Donc on m’a donné la synthé de toute la musique. Je me suis retrouvé à bosser avec Roy Ayers (légendaire artiste soul, NDLR) qui a composé le seul morceau original de la B.O. Donc j’ai fait une session avec lui où j’ai produit le titre. Ça, c’est l’expérience musicale d’une vie. C’est Puma qui avait organisé ça parce qu’ils étaient en partenariat avec Roy Ayers. Vraiment mortel, une super aventure. Vous aviez combien de temps pour travailler avec Roy Ayers ? Une soirée. Mais j’ai rarement vu un gars bosser comme ça. Il est venu, il a écrit le morceau en dix minutes. Il était venu avec ses musiciens, ils ont fait trois à quatre prises de dix minutes. Le gars me fait : “tiens, Jérôme, là tu as quarante minutes de musique, je te fais confiance, tu te débrouilles”. C’était mortel. Mortel, mortel. Tu as passé la soirée avec lui après ? Je ne sais pas si je peux raconter l’anecdote, putain… Le problème… Bon je m’en fous, le problème, c’était qu’à cette époque-là, à Londres, les champignons hallucinogènes, c’était genre légal, tu pouvais en acheter partout. J’étais à Londres en train d’enregistrer avec Roy Ayers dans un studio à Camden et je sors pour faire une pause. J’étais euphorique, c’était la plus belle journée de la vie, j’enregistrais avec Roy Ayers. Et là, il y a un gars qui vend des champignons hallucinogènes. Toutes les boutiques en avaient. Moi j’en n’avais jamais pris de ma vie, et je me dis : “putain, faut que je fête ça.” Je ne savais pas quoi faire, je n’ai jamais bu beaucoup d’alcool. Donc je me dis : “allez, je vais prendre des champignons.” J’avais fini d’enregistrer et j’ai pris les champignons. Et j’ai eu une telle montée que j’ai dû aller me cacher chez mon ami et j’ai passé la nuit dans la chambre de mon pote à avoir des visions au lieu de passer le reste de la soirée avec Roy Ayers… (rires) Gros regrets et grosse erreur de jeunesse de merde (rires), mais je n’ai plus jamais repris de champignons après. Bref, je les mange et je commence à mixer le morceau. Sauf que je commence à voir la musique. Je voyais la musique qui sortait de la console et j’ai compris que ça allait être difficile. Puis à un moment, j’ai dit : “merci infiniment, il faut que j’y aille”. Mais j’ai revu Roy Ayers quelques années après quand j’habitais à Los Angeles, et on a passé toute une après-midi ensemble. J’ai rattrapé le temps perdu. Il y avait qui d’autre sur cette B.O. ? C’était le seul morceau original. Sinon, Irfane avait fait quasiment toute la musique. Et la B.O. n’est jamais sortie en tant que telle, il me semble. Peut-être en promo. C’était assez difficile de licencier les morceaux à l’époque. C’est la première fois que tu faisais un pas dans le monde de la production de film ? C’est la toute première fois. Et ensuite, tu as bossé sur le fameux Babylon A.D. avec Mathieu Kassovitz. Comment tu te retrouves à travailler sur ce film-là ? D’abord, je me suis retrouvé à bosser avec Vin Diesel pendant un an et demi. Bizarrement.
Le trailer de Babylon A.D. de Mathieu Kassovitz
Ok, commençons par là. Comment as-tu rencontré Vin Diesel ? Je l’ai rencontré en boîte de nuit. Moi je mixais, j’étais dans une période un peu difficile. Je venais de me séparer de ma copine de l’époque. Je le rencontre en boîte de nuit et je me rends compte que finalement le mec est hyper cool et on discute parce qu’on avait un pote en commun dans la boîte, c’était une toute petite boîte. On discute et le mec vient du Hip-hop. Et donc on avait plein d’amis en commun parce que moi, à la fin des années 90, j’allais tous les ans à New York pour l’anniversaire du Rock Steady Crew (mythique crew fondateur du Bboying, qui organise chaque année un festival Hip-hop à l’occasion de son anniversaire, NDLR).Clique x Vin Diesel
Je connaissais pas mal tous les breakeurs à New York, et on se rend compte qu’on a pas mal d’amis en commun.Et je lui dis : “mec, je vais être honnête avec toi, – parce que j’étais un peu saoul –, j’ai jamais vu de film de toi mais avec Van Damme et Steven Segal, tu dois être un des trois pires acteurs au monde, j’espère que t’es au courant quand même”. Le mec me regarde et fait : “t’es fou” – genre personne ne lui a jamais dit un truc pareil, un truc de malade – et il me fait : “donne-moi ton numéro”.Moi je suis en train de me séparer de ma meuf, le mec me rappelle le lendemain et il me dit : “écoute, c’est bizarre, j’ai viré mon manager une heure avant de te rencontrer parce que je pense exactement la même chose que toi. Personne n’a jamais osé me le dire de ma vie. Là, je pars à Saint-Tropez lire des scénarios. Toi, tu ne connais rien au cinéma. Est-ce que ça ne te dirait pas de venir lire les scénarios ? Parce que tu es la seule personne honnête que j’ai rencontrée depuis des années et j’aimerais bien avoir ton avis”. Bon, je n’étais jamais allé à Saint-Tropez, je me dis : pourquoi pas ? Donc le dicton “sois honnête et fais ce que tu peux”, ça marche ? Oui, ça marche bien ! (sourire) Finalement, je suis parti avec un sac à dos et je suis rentré un peu plus d’un an après. Je l’ai accompagné dans le monde entier sur des tournages, dans la production de films, de repérages. Il n’y avait pas de manager, pas d’assistant. C’était lui, son garde du corps et moi à faire le tour du monde, à lancer des projets, à faire des trucs et donc, Babylon A.D. Et c’est comme ça que j’ai rencontré Mathieu. À chaque fois que tu te lances dans un nouveau projet, comment tu fais pour expliquer aux gens du projet précédent : “bon désolé, mais je dois partir avec Vin Diesel.” Ils ne doivent plus te croire au bout d’un moment...
C’est vrai qu’on m’a fait le coup du mytho, c’est pour ça que je ne raconte pas trop ma vie en général. Parce que le coup du mythomane, on me l’a sorti.Parce qu’à l’époque où tu es engagé par Vin Diesel, tu fais quoi ? DJ ? Oui, DJ résident avec Irfane et on venait de finir notre album. Du coup, tu vas voir Irfane qui est ton pote et tu lui dis : “écoute mec, je dois partir pendant un an avec Vin Diesel…” ? Mais non ! Parce que moi j’étais parti pour un week-end à la base. (rires) Je n’avais pas du tout prévu de partir pour un an. J’étais plutôt parti pour trois jours. Mais après, c’est ça qui est génial avec la communication, Internet, les e-mails : je suis resté en contact. On venait de finir un album. On n’avait pas prévu d’en faire un autre tout de suite. En revanche, le bullshit hollywoodien et tout ça, ça m’a vite saoulé, et c’est moi qui suis parti au bout d’un an. C’était trop artificiel. C’était vraiment l’argent et l’argent. Lui était cool, super sympa, vraiment correct, mais tout ce qu’il y avait autour… Du coup, tu as réussi à lui faire faire des meilleurs films ? Je ne suis pas sûr. Je suis arrivé à lui faire faire Babylon A.D. mais je ne sais pas si c’est un meilleur film. (selon son réalisateur, la réponse est non, NDLR) Par contre, ce qui était mortel, c’est que quand je l’ai rencontré il venait de faire un film qui s’appelait Find me guilty par mon réalisateur préféré, Sidney Lumet, qui avait fait Network par exemple, et Douze hommes en colère. Je me suis donc retrouvé pas mal de fois avec Sidney Lumet. On a fait le Festival du film de Berlin ensemble, donc ça c’était assez incroyable de pouvoir avoir la chance de passer du temps avec ce génie du cinéma. Est-ce qu’on peut dire que tu t’es consolé de ta rupture amoureuse grâce à Vin Diesel et ton réalisateur préféré ? C’est un peu ça, aux frais d’Hollywood. Mais c’est surtout la connexion avec le Hip-hop. Ça aussi, c’est un peu un des fils conducteurs. C’est pour ça que je me suis super bien entendu avec Mathieu aussi. C’est Kassovitz qui m’a demandé de m’occuper de la musique de Babylon A.D. justement. Mathieu est venu chercher Vin Diesel, et moi je l’ai convaincu de le faire. A tort ou à raison. Ce qui est fait est fait. Pauvre Mathieu. Je ne sais pas si j’ai fait un cadeau à Mathieu en convaincant Vin de le faire, mais après, deux fortes personnalités, ça ne marche pas toujours. Après, je suis resté pote avec Mathieu, et pas plus que ça avec Vin. C’est Mathieu mon pote aujourd’hui.
Clique x Mathieu Kassovitz.
Mais le Hip-hop, c’est un peu mon fil conducteur aussi. Dans tout ce que j’ai fait, c’est cette passion pour le Hip-hop qui m’a aidé. Je pense que quand tu as grandi dans le Hip-hop, cela te marque profondément. Et c’est bizarre, tu rencontres des gens dans des endroits ou des métiers qui n’ont rien à voir avec toi et d’un coup, tu dis « Hip-hop okay. Rock Steady Crew, oui. Wu-Tang, ah. Gangsta rap, aussi. »Et là d’un coup, tu as l’impression que tu connais le mec depuis vingt ans ou trente ans. C’est trop bien, c’est un truc qui m’est arrivé souvent dans la vie. Beaucoup des grandes rencontres dans ma vie, elles ont été autour de la culture Hip-hop. En parlant de rencontres, quelle est selon toi celle qui t’a le plus marqué, hormis ta femme, évidemment… RZA, sans hésiter. Et une des rencontres que tu aimerais faire ? J’ai jamais poussé… J’aimerais bien rencontrer Pharrell. Quand tu aimerais rencontrer quelqu’un, est-ce que tu essaies de voir par quel biais tu pourrais le faire ? Le truc, c’est que je pense que je vais le rencontrer dans trois semaines à peu près. Parce que j’étais à Miami la semaine dernière, et par hasard, j’ai dîné avec un ami à moi qui avait invité Chad Hugo des N.E.R.D. Donc on était tous les trois à dîner. Et j’accompagne RZA et le Wu-Tang les 13 et 14 juillet dans un festival à Londres. RZA va faire un peu de promo avec moi pour mon projet et les N.E.R.D. jouent le même soir. Et vu que je connais Chad maintenant, je croise les doigts… Après, les festivals, c’est un peu un mauvais endroit pour rencontrer les artistes. Mais bon, Pharrell c’est quelqu’un qui m’a beaucoup influencé artistiquement. Comment ? Musicalement parlant. Après en termes de vêtements, un peu moins. (rires) Mais en termes de musique, c’est quelqu’un qui est arrivé à faire des trucs tellement variés sur trois décennies, c’est incroyable pour moi. Dr. Dre, encore plus, j’adorerais le rencontrer ! On a eu la chance de le rencontrer récemment avec Jimmy Iovine… Ah marrant, j’ai un ami à moi, sa sœur s’est mariée avec Jimmy Iovine il y a un an. Il m’a raconté quelques anecdotes, il a l’air bien à bloc. Après, je pense que la notoriété, tout ça, c’est assez dur à vivre. RZA, par contre, semble hyper heureux. Mais il travaille à son bonheur, c’est un effort. C’est pas l’argent qui te rend heureux, c’est pas d’avoir ta tête en couverture sur les magazines. C’est de bien s’occuper de sa famille, c’est entretenir les relations avec tes proches, c’est vivre sainement.
RZA fait du sport tous les jours, il est végétarien, il fait attention à ce qu’il bouffe, il médite tous les jours. Il travaille à son bonheur, c’est pour ça que je dirai que RZA, c’est la plus grande influence que j’ai eu dans ma vie parce que c’est un modèle.Quand tu sais d’où il vient, c’est vraiment atroce. Tellement de gens autour de lui se sont fait buter. Il a vu tellement de violence, tellement de drames… Mais tu vois qu’il a réussi à complètement transformer ça et le type travaille, travaille, travaille. Il est tout le temps sur quelque chose. Bon, je ne veux pas faire le sarkozyste sur la valeur du travail mais il a vraiment trouvé son équilibre, un équilibre entre le travail, la famille et les relations humaines. C’est un des plus grands producteurs qui a marqué ces deux dernières décennies, mais il ne prend jamais rien comme acquis. Il recommence tout le temps à zéro. C’est cette capacité à se remettre en question, à accepter de recommencer à zéro en permanence, à garder cette curiosité d’enfant, à ne pas être blasé par quoi que ce soit qui sont des choses que j’ai apprises avec lui, énormément. Tu as bossé avec Hans Zimmer aussi ? Oui, c’était sur la B.O. de Babylon A.D.. Dans le genre “mec qui travaille”, je n’ai jamais vu des gens qui travaillent autant que lui. C’est une machine. Comment l’as-tu rencontré ? Par Kassovitz et la Fox. La Fox a mis Hans Zimmer dans la boucle, et moi j’ai ajouté RZA. Initialement, c’est Dr. Dre qui devait faire la B.O. Mais à la dernière minute, il a dit à Mathieu qu’il ne pouvait pas la faire. Mathieu savait que j’étais très pote avec RZA et donc, il m’a demandé de le faire avec lui. Je mets avec RZA dans l’histoire, mais la Fox dit : “c’est bien de mettre des rappeurs mais il faudrait un compositeur un peu classique, et tant qu’à prendre un classique, on va prendre Zimmer”. On a fait ça dans ses studios, et là RZA a rajouté Shavo Odadjian du groupe System of a Down, qui est son super pote, et George Clinton. Donc j’étais dans les studios de Hans Zimmer avec RZA, System of a Down et George Clinton pendant cinq mois. Et Babylon A.D. porte très très bien son nom. Ils appelaient nos sessions les « babylon sessions » chez Hans Zimmer. C’est toujours le cas il me semble. Je crois qu’on les a un peu traumatisés. Je ne sais pas si je suis ultra bienvenu là-bas… Mais je suis fier du boulot qu’on a fait sur la musique. Un mix entre heavy metal, rap, et techno futuriste. Pour un monde apocalyptique, je pense qu’on a fait un truc assez cool.
Ça se passait comment, les sessions ? C’est n’importe quoi. En gros, il y avait des musiciens classiques qui venaient à dix heures du mat’. Ensuite l’après-midi, vers 16h, les rockeurs arrivaient. Vers 22 heures, RZA débarquait avec ses cousins. Et enfin, vers une heure du mat’, il y avait George Clinton, en dernier toujours, et ça finissait à 6 heures. Et moi, il fallait que je sois de nouveau là à 10 heures du mat’. J’ai dormi deux heures par nuit pendant cinq mois. Ça, c’était éprouvant, plus éprouvant encore que la tournée du Wu-Tang. Il y a une photo que je vais te montrer et que j’aimerais bien que tu commentes. Comment ça se fait qu’en 2007, tu es au Mali avec le ministère de l’Intérieur du gouvernement français ? Putain, tu as retrouvé ça.
La photo date de 2007. Au même moment, tu travailles pour Vin Diesel et tu sors un nouvel album. Explique-nous. C’était entre les deux. En gros, ce qui s’est passé avec Vin, c’est que j’avais bossé avec lui et les Nations Unies sur un projet humanitaire pour amener de l’eau en Afrique. Ensuite, au bout d’un an – ce qui est normal – Vin Diesel embauche un vrai manager. Moi j’avais 24 ans, je ne connaissais rien au cinéma. Il était temps d’arrêter la blague. C’était drôle mais honnêtement, on faisait plus la fête qu’autre chose. Moi j’étais plus qualifié en tant que DJ que manager hollywoodien. Bref, il embauche un vrai manager qui m’appelle et me dit : “bon là, ton projet caritatif, on va laisser tomber”. C’était avant Angelina Jolie, George Clooney et tout ça, et le mec disait que le caritatif, ça tue une carrière d’acteur.
Quand j’ai entendu ça, j’ai envoyé un texto à Vin Diesel : “ton manager c’est un enculé, moi le seul truc qui me motive c’est ce projet caritatif. Tu ne veux pas le faire, à bientôt”.On s’est revus deux ou trois fois mais on s’est un peu séparés là-dessus. Je me retrouve à Paris, je lâche ma villa à Beverly Hills avec deux 4x4, deux pitbulls et une piscine ; je lâche tout ça et je me retrouve à dormir sur le canapé chez mon frère à Paris. Et là, Mathieu avec qui j’étais resté pote m’appelle et me dit : “au Quai d’Orsay, Philippe Douste-Blazy est en train de monter un projet humanitaire qui s’appelle United, pour aider à lutter contre la malaria, le sida et la tuberculose. Ils veulent récupérer un euro par billet d’avion et aimeraient bien impliquer des célébrités, des gens pour promouvoir l’initiative”. Et vu que je venais de passer un an à Los Angeles, je connaissais à peu près toutes les stars de là-bas, donc je me dis que je vais aider à faire ça, de manière bénévole. Mathieu me présente à Douste-Blazy. J’ai un rendez-vous avec lui, je lui présente quelques idées de ce que j’aimerais faire. Je rentre chez moi, cool. J’ai eu une réunion au Quai d’Orsay, génial. Et là je reçois un coup de fil à 22 heures : “Jérôme, c’est Philippe Douste-Blazy, je rentre de Genève. Je suis dans l’avion. Est-ce que vous pouvez venir à 6 heures demain matin prendre le petit déjeuner au Quai d’Orsay ?” Tu ne dis pas non au Ministre des Affaires étrangères. “Oui, bien sûr”. Le lendemain matin, j’arrive au Quai d’Orsay. Il y a Douste-Blazy avec ses dix conseillers. - M. Hadey, j’ai beaucoup aimé votre discours d’hier. Que faites-vous en ce moment ? J’ai compris que vous ne faisiez rien. - Oui mais bon... - Vous faites quelque chose ou rien ? Rien... Donc vous allez travailler pour nous, d’accord ? - Euh oui... - C’est quoi vos conditions ? - Il me faut ça, ça et ça. - Parfait, bon, quand est-ce que M. Hadey peut commencer à travailler avec nous ? Ses conseillers répondent que si tout se passe bien, dans un mois tout sera réglé. - Bon parfait, on est tous d’accord pour que M. Hadey commence demain matin. Je vous vois demain matin à 8 heures. Bonne journée, M. Hadey.
Bon ben je travaille au Quai d’Orsay je crois (rires). Et le lendemain, j’avais un bureau, un étage au-dessus du ministre au Quai d’Orsay, avec deux assistantes pour organiser mon truc.Mais après le truc est devenu un peu foireux parce qu’on commençait à entrer dans l’année des élections, c’est Chirac qui était encore président. C’était juste avant que Sarkozy ne soit élu en 2007. Dans les artistes que j’avais ramenés, il y avait Lionel Richie par exemple qui voulait participer au projet. Puisqu’il avait fait We are the World, ça correspondait assez bien. Mais le problème, c’est que Sarkozy et les politiques voulaient récupérer la présence des artistes pour la campagne. Et ça, moi, je ne voulais pas vis-à-vis des artistes. Je ne voulais pas qu’on utilise leur image pour la campagne présidentielle. Ça fait que finalement je me suis retrouvé à bosser sur plein d’autres choses avec Douste-Blazy. Par exemple, déjà en 2007, on bossait avec Ban Ki-Moon qui était Secrétaire général des Nations Unies sur l’arsenal chimique de Bachar Al-Assad, entre autres. Mais encore ? J’avais des rendez-vous, des conversations avec des Prix Nobel de la Paix. Moi je n’avais pas prévu de carrière en politique et j’ai été honnête avec Douste-Blazy. C’est pour ça qu’il m’aimait bien et trouvait que j’avais un peu de bon sens. Il me demandait mon avis sur tout. Moi je m’en foutais, j’étais le seul qui n’avait pas d’intérêts.
Une fois il m’a demandé : “tu penses quoi de mon numéro 2 ? – C’est un gros connard. – Ah bon ! Pourquoi est-ce que c’est un gros connard ? – Ben, il a fait ça, ça et ça, c’est un escroc. – C’est vrai, je le sais mais personne ne me le dirait, ça.” Ce genre de choses. C’est pour ça qu’il m’emmenait avec lui sur plein de réunions.Mais à la fin, autant je n’avais pas de problème particulier avec le sida, la tuberculose, tout ça c’est de l’humanitaire, c’est quelque chose qui dépasse les partis ; mais je ne suis pas particulièrement de droite, si on peut le formuler comme ça, en tous cas pas du tout sarkozyste. Donc, après que Sarkozy ait été élu, Mathieu m’a appelé et m’a dit : “Jérôme, on a fini de faire Babylon A.D. Dr Dre vient de dire non. Est-ce que tu veux venir faire la B.O. du film avec moi ?” Et c’est comme ça que ça s’est calé entre Vin Diesel et la B.O. Qu’est-ce que tu aimes faire dans la vie ? J’aime bien avoir des visions et les matérialiser. Et souvent des visions partagées. C’est cette magie qu’on a en tant qu’être humain de pouvoir imaginer des choses qui n’existent pas et de les faire devenir réalité. Et en plus de ça, si elles peuvent avoir un impact positif sur les gens, pour moi c’est quelque chose de tellement incompréhensible, cette capacité à faire ça. Je pense que c’est ça qui me motive le plus. C’est une forme d’utopie ou pas pour toi ? Oui, mais une utopie réaliste, parce que les choses existent au final. Après, j’ai fait beaucoup de choses; mais j’ai eu un million de rêves que je n’ai pas réalisés. J’ai écrit je ne sais pas combien de scénarios, j’ai des idées de séries télé, j’ai fait beaucoup de peintures, d’expositions qui ne sont jamais sorties. Il y a plein de choses qui ne se font pas, mais une fois sur cent, une fois sur dix, il y a un truc qui existe et c’est déjà fantastique. Pour moi, la capacité d’imaginer les choses, et la capacité de les matérialiser, c’est pour ça que la vie vaut la peine d’être vécue. Après mon épouse et mon enfant, bien évidemment.
Avec ton épouse Lena et Lionel Bensemoun, qui a créé certaines des adresses les plus emblématiques de Paris, vous avez monté un lieu unique en Italie, la Villa Lena. Ta route est pavée de rencontres. Une des grandes rencontres de ta vie, c’est ta compagne actuelle Lena. Comment vous êtes-vous rencontrés ? C’était à une époque où je mixais beaucoup, et j’avais mixé pour l’ouverture d’une galerie d’art à Moscou qui s’appelle le Garage, un centre d’art contemporain sur la Reva. Ma future épouse était l’une des organisatrices de l’événement. Et j’aime aussi bien raconter qu’avant nous, il y avait Amy Winehouse qui jouait. Vous avez discuté ? Non, elle était trop bourrée. Elle n’arrêtait pas de dire “joyeux anniversaire, joyeux anniversaire !” pour l’inauguration de leur centre d’art. Ça m’a fait de la peine. Le concert était magique mais c’était assez dur à voir quand même. Elle était déjà en fin de parcours. C’est là qu’on s’est rencontrés avec ma femme, ça fait dix ans maintenant. Et c’est à ce moment-là que j’avais signé chez Universal en musique avec Outlines et Irfane. Ça ne s’est pas particulièrement bien passé. C’était les années très difficiles de l’industrie, le moment où personne ne comprenait comment le streaming allait rapporter de l’argent. Tout se cassait la gueule, tout le monde se faisait virer, c’était “sauvez les meubles, un grand navire est en train de couler”. Irfane, lui, il avait son succès avec Breakbot. Étant parti plusieurs fois faire mes trucs à moi, je ne pouvais pas l’empêcher de faire ses trucs à lui. Je l’ai poussé à poursuivre ça et ça a plutôt bien marché. Par ailleurs, les parents de mon épouse se sont retrouvés avec une propriété en Toscane assez énorme et qui était complètement abandonnée, et en partie détruite. Au début, avec mon épouse, on est venus avec le projet d’en faire une ferme bio, une résidence d’artistes et un hôtel. Et j’avais rencontré Lionel Bensemoun en 2002, parce qu’à l’époque il était imprimeur et qu’il s’occupait des cartes de visite de Pedro Winter. Je pense qu’on ne s’était pas vus pendant dix ans pratiquement, et j’avais adoré ce qu’il avait fait avec l’Hôtel Amour. C’était une super ambiance, ils n’avaient pas investi de sommes astronomiques, c’était assez simple mais c’était autour du monde de l’art. Donc pour la Villa, j’ai tout de suite appelé Lionel, qui est venu en Toscane et qui s’est jeté dans l’aventure.
Aujourd’hui, c’est notre sixième année sur ce projet. On a eu à peu près cinq cents artistes en résidence. C’est une sacrée aventure et ça n’est pas près de s’arrêter.Il y a une histoire qui raconte que le lieu est hanté ? Alors, Elvira, qui était la fille magnifique du village d’à côté, a effectivement été assassinée sur le domaine et hanterait les lieux. Il y a eu deux suspects : son mari et son amant. Et de ces deux suspects, on n’a jamais su qui était le vrai coupable… Sachant que l’un des deux est décédé à l’âge de cent ans quasiment il y a un an ou deux, et a emporté le secret avec lui dans sa tombe. L’histoire c’est que, quand ça s’est passé, l’affaire avait pas mal défrayé la chronique en Italie, mais en plus dans la foulée, un écrivain dont j’ai oublié le nom a écrit un roman autour de ça, ambiance très Agatha Christie. Il paraît que c’est une histoire assez connue en Italie. À quel moment tu te retrouves au milieu de la Toscane dans cette propriété complètement détruite avec ta femme et vous vous dîtes : “c’est là qu’on pose nos valises” ? J’avais déménagé à Londres pour être plus près de mon épouse, à ce moment-là. Je ne suis pas particulièrement fan de Londres. Et finalement, à un moment donné, ses parents s’étaient retrouvés avec cette propriété abandonnée et nous ont demandé à Lena et moi de faire une petite étude pour voir et trouver quelqu’un qui pouvait éventuellement développer un hôtel sur les lieux. On est allés voir deux-trois agences qui font ça et elles nous ont toutes proposé des projets dégueulasses du genre voilà le spa, le truc en marbre, les dorures par-ci par-là. On a fait un peu l’inverse de ce qu’on t’apprend en école de commerce, là où on te dit : “fais bien ton étude de marché, ce que le marché demande, ce dont le marché a besoin, etc…” On a fait l’inverse, on s’est dit : ce type d’endroit, ça va attirer tous les gens avec qui on n’a pas envie d’être. L’idée nous est venue en contrecoup de ces propositions d’hôtel un peu pourries et on s’est dit : comment on pourrait créer quelque chose qui nous ressemble et qui plairait à nos amis ? Et nos amis, ça va d’étudiants en art aux fils de machin. L’idée, c’est de faire un truc qui puisse accueillir tout le monde ; et je pense que le fil conducteur de tous ces gens, c’est l’art. Finalement, on s’est rendus compte que l’hôtel où on se sentait le plus à l’aise avec nos amis, c’est l’Hôtel Amour à Paris, et c’est pour ça qu’on a appelé Lionel. Mais après le projet s’est un peu fait de fil en aiguille. C’est avec les gens qui sont venus qu’on a développé le projet. On n’avait pas une idée fixe. Au début, c’était nos amis artistes qui sont venus et c’est comme ça que la résidence s’est faite. Après il y en avait pas mal qui étaient dans l’agriculture, dans le bio, donc ça s’est rajouté. Il y a aussi la décoratrice Clarisse Demory qui est impliquée dans ce projet ? Oui, elle s’est occupée de la décoration parce que c’est elle qui avait la patience et le courage de venir tout au début avec nous. Elle est venue quand tout était encore abandonné, quand il n’y avait pas vraiment d’électricité, pas vraiment d’eau. La pauvre, elle a habité six mois, un an chez nous. Elle a fait tous les dépôts-vente du coin et elle a choisi pièce par pièce chaque chaise, chaque table, chaque lampe. Elle a trouvé des objets incroyables, quitte à revenir bredouille après cinq heures dans des brocantes. Je pense que c’est la plus grande spécialiste des brocantes et dépôts-vente de Toscane, elle a vraiment tout choisi, pièce par pièce.
Il paraît qu’il y a même une DJ de Calvi qui est devenue la chef des cuisines ? Exactement. (rires) Stéphanie. C’était complètement freestyle et c’est ça qui fait que ça a été fait avec nos amis pour nos amis. Je pense que c’est ça : on parlait d’honnêteté et de sincérité, c’est ça qui en fait un truc hyper honnête. Il y a zéro idée marketing derrière. On n’a jamais pensé à la revente, aux clients. On s’est dit : “comment on peut faire le plus plaisir à nous et nos amis ?”
La Villa Lena offre des résidences à des artistes. Pour y avoir droit, il faut déposer une candidature auprès d’un jury composé, entres autres, de Philippe Zdar et RZA. Concrètement, comment ça se passe ? On reçoit à peu près cinq-cents candidatures par an. Lena fait un premier tri avec notre équipe en interne, car il y a des trucs qui ne sont pas sérieux du tout. On prend trois types d’artistes : soit des artistes très très jeunes, qui sortent du lycée, qui n’ont encore rien fait, c’est un petit pourcentage.
Et sinon, la majorité des artistes qu’on prend, ce sont des gens qui ont montré qu’ils sont capables de vivre de leur art ou de le transformer en un truc professionnel mais qui n’ont pas encore réussi et galèrent encore un peu. Comme ça, on peut leur donner un dernier coup de pouce pour rencontrer d’autres gens et réfléchir à ce qu’ils veulent faire pour relancer un peu leur carrière. On a quelques artistes au nom confirmé. Voilà le genre qu’on prend, peu importe la discipline.On a eu des architectes, des peintres, des danseurs, des musiciens, des écrivains, des designers, un peu de tout. Donc sur ces cinq-cents dossiers, je dirais qu’il y en a à peu près la moitié qui vire car ce n’est pas très sérieux. Il reste à peu près 250 candidatures pour une soixantaine de places par an et ces candidatures, on les fait passer au jury qui les regarde, qui note quasiment toutes les candidatures et qui donne leur favoris. Derrière ça, on fait une sélection d’une centaine de candidats avec le jury et après, on interviewe les cent sur Skype deux fois et pour venir à cinquante, soixante. C’est un processus qui dure quatre mois à peu près. Ça, c’est grâce à ma femme, qui est beaucoup plus rigoureuse que moi. Ce n’est pas Le Loft, il n’y a pas de caméra, mais tu es quand même à huis clos et donc le côté humain joue énormément. On ne peut pas juger que sur la qualité de l’art. C’est quand même primordial. Si la qualité de l’art n’est pas là, il n’y a pas d’intérêt à prendre les gens, mais il y a vraiment un côté humain. C’est pour ça qu’on fait plusieurs entretiens avec les gens. Car si tu mets un connard dans le lot, ça bousille toute la résidence. J’ai vu ça il y a deux mois. 95% du temps, ça se passe bien. Un gars qui se plaint tout le temps, dans un petit univers comme ça, ça pourrit tout, tout de suite. Parmi les cinq-cents artistes qui sont venus ces six dernières années, lesquels ont réalisé dans vos murs des œuvres majeures ? Il y a Benjamin Clementine qui a écrit tout son album chez nous. Francis and the Lights aussi. D’ailleurs, tu es crédité sur l’album de Francis and the Lights sorti en 2016 ? Oui, lui aussi il a bossé sur mon album. Il est arrivé chez moi complètement dépressif, au bout du rouleau. Justement, en tant qu’artiste, il avait déjà produit pour Drake, donc il ne venait pas de nulle part. Mais il était un peu au bout du rouleau, il ne savait pas trop quoi devenir et il est venu trois fois en résidence. Et il a écrit pratiquement tout son album qu’il a fini chez Bon Iver. Et donc comment t’es-tu retrouvé à produire sur son album ? On a fait de la musique ensemble. Il y a un des titres qu’il a gardé, et moi j’ai gardé un autre titre. J’ai gardé Never for money, always for love, le premier titre de mon EP qui vient de sortir. Il a bossé sur l’album de Kanye West chez toi ? Non, non, ça ils l’ont fait chez Kanye, malheureusement (rires). J’aurais bien aimé que ce soit le contraire. Kanye est déjà venu à la Villa Lena ?
Je ne sais pas s’il est au courant. C’est un peu sa gamberge ce genre de concept, en revanche je ne sais pas si Kanye c’est ma gamberge. Je ne sais pas quoi penser de lui pour être honnête. Je n’arrive pas à avoir d’avis. Après pour moi quand tu flirtes avec Trump, tu es du mauvais côté de la barrière.Il y a d’autres artistes connus qui sont passés en résidence chez vous ? Pas forcément, mais on a plein de designers. Par exemple, Lena était à Basel la semaine dernière et il y avait une dizaine ou une quinzaine d’artistes passés en résidence chez nous, qui étaient exposés là-bas. Des artistes qui étaient loin d’avoir une chance d’être à Basel il y a de ça trois-quatre ans. Il y en a un qui s’appelle Ridley Howard. Il est très fort. Est-ce qu’il y a un moment à la Villa où tu as regardé autour de toi et tu t’es dit : “ça y est, cette utopie qu’on voulait créer est devenue réalité.” ?
L’été dernier. Christine and the Queens est venue en vacances chez nous pendant une semaine. Il y avait Christine and the Queens, des jet-setters de Miami et de Los Angeles, et des agriculteurs italiens du fin fond de la pampa toscane.On a fait une soirée où il y avait un mix surréaliste de gens qui dansaient au bord de la piscine et qui échangeaient. On ne savait plus qui travaillait dans les champs, qui venait de Miami, qui était une star de la chanson. Tout le monde s’amusait. Quand tu vois ces gens, tu te dis : « jamais ils ne se rencontreraient, jamais ils n’échangeraient ». Là ils rigolaient ensemble, ils échangeaient, et pour moi, c’est un des buts de la Villa Lena, et même de beaucoup de choses que j’ai faites dans ma vie. J’aime bien l’idée que les barrières qui existent entre les humains, soient artificielles pour la plupart d’entre elles : les barrières sociales, les barrières culturelles, les barrières philosophiques, idéologiques. C’est des choses montées de toutes pièces. Alors pourquoi et comment, on peut en débattre, mais je pense qu’elles sont inutiles. Et qu’avec la Villa Lena, le fait de créer un lieu qui capte ces barrières, qu’elles soient justement sociales, culturelles ou autres, qu’il n’y ait d’élitisme sous aucune forme, pour moi c’est notre plus grande réussite. C’est la chose dont je tire le plus de fierté par rapport à ce projet.
Jerome Hadey feat. J Caesar - Never for Money, Always for Love.
Je pense aussi à l’approche de Lionel, car il a toujours voulu faire des choses qui rassemblent, pas des choses qui divisent. Surtout dans une époque où on est à fond dans l’individualisme. Je pense qu’on oublie qu’il y a beaucoup de plus de choses qui nous unissent que de choses qui nous séparent. Donc quand tu as des moments comme ça, où des gens de tous horizons se retrouvent et passent un bon moment, c’est là que je me dis : ça a marché. Ton premier EP en solo Never For Money Always For Love est sorti le mois dernier. Trois morceaux, trois featurings… Oui, avec RZA, Quendresa et J. Caesar. Les deux derniers c’est deux jeunes de Londres que j’ai rencontrés et qui sont venus à la fondation. Là, l’idée c’est de monter un label. On commence à lancer cette aventure avec quelques artistes. Avec RZA aussi ? RZA est dans l’aventure toujours.L'EP 'Never For Money Always For Love' de Jérôme Hadey
Ce qui est génial, c’est que tu as quand même réussi à faire faire à RZA un morceau presque techno sur lequel il ne rappe pas… Oui, mais déjà il avait fait un morceau avec I :Cube de Château Flight sur Versatile. Il avait déjà fait un morceau électronique, il avait déjà flirté avec ça. Et j’avais juste cette vision où je voulais quelque chose de positif, un texte un peu visionnaire qui inspire les gens à devenir de meilleures personnes. Donc j’ai dit à RZA : “j’aimerais bien que tu parles et que tu dises un truc un peu positif pour inspirer les gens.” Il m’a dit instantanément “j’ai exactement ce qu’il te faut” et apparemment, il avait écrit un texte très peu de temps auparavant dans son téléphone. Qui retrouvera-t-on sur ton album qui sort en septembre ? Il y a quelques morceaux instrumentaux aussi. Un autre morceau avec RZA et aussi un avec un jeune qui s’appelle Magnus Chapel. Un petit jeune de 19 ans, incroyable.Jerome Hadey feat. RZA, Tomorrow.
Comment t’est revenue l’envie de refaire de la musique ?J’ai eu un cancer il y a trois ans et on m’avait donné trois mois à vivre. Une sale version du cancer de l’estomac. Je n’avais plus de chance de m’en sortir et là finalement je suis sorti d’affaire. Pendant la maladie, la seule chose que j’ai eu envie de faire et que j’avais arrêté, c’était de la musique.Et RZA est venu me voir plusieurs fois. Pendant que j’étais malade, c’est lui qui m’a remis le pied à l’étrier en mode “si c’est ce que tu as envie de faire, c’est ce qu’il faut que tu fasses. Il faut que tu fasses de la musique”. Et quand RZA te dit qu’il faut que tu fasses de la musique, tu fais de la musique. C’est peut-être un peu exagéré de dire que c’est ça qui m’a guéri, mais c’est sûr que ça y a contribué. J’étais toujours de bonne humeur et je pense que c’est en grande partie grâce à la musique. C’est là que je me suis vraiment rendu compte à quel point j’avais besoin de la musique pour vivre, que c’était mon truc. C’est mon fil conducteur à travers toutes ces années. Faire de la musique, c’est ce qui me passionne le plus. On verra, mais là je pense que j’ai trouvé un certain équilibre où j’ai mon studio en Toscane, donc je peux faire de la musique tout le temps, et en plus, j’ai plein d’artistes qui viennent me voir. Ce qui fait que je peux faire plein de projets à droite à gauche. Je n’ai plus besoin de partir dans tous les sens. J’ai tous les gens qui viennent à moi. Par exemple, là j’ai un magicien assez génial qui s’appelle Tom London qui va être résident chez nous ; c’est un hacker. C’est un type qui, dans une salle, va hacker les téléphones de tout le monde pour faire des expériences assez incroyables et là il fait des œuvres d’art qui sont des miroirs. Il y a des tweets en direct qui sont répartis et qui bougent selon comment toi tu bouges. Là, je vais faire de la musique pour son expo et pour ses œuvres. C’est mon projet du moment, et c’est marrant parce que ça me permet de mettre un pied dans le monde de la magie. J’ai commencé la semaine dernière.
Est-ce que tu crois en Dieu ? Ah oui ! bien sûr ! Il paraît qu’à une époque, avec ta copine, tu te serais converti à l’Islam ? J’ai une grande passion pour l’Islam. Ma copine de l’époque était Warda Mellouki, une rappeuse d’un groupe strasbourgeois qui s’appelait Meufia. J’étais aussi assez proche à l’époque du rappeur Abd al Malik qui m’a pas mal ouvert les portes au soufisme et à la religion. J’ai énormément de respect pour les religions quelles qu’elles soient, même si aujourd’hui je ne suis plus particulièrement religieux. Parce que la religion ça dépasse la spiritualité. Ça englobe la culture aussi.
Donc, je me considère plus spirituel que religieux.La spiritualité est quelque chose qui t’a aidé dans ton parcours ? Oui. Après il y a un truc où en Toscane, au milieu des oliviers, on se sent beaucoup plus proche de Dieu et on a moins besoin de religion. Dans la mesure où dans les grosses villes, on se sent tellement oppressé, on ne peut que regarder en ligne droite. Ton esprit est complètement enfermé, tu es tout le temps en conflit intérieur et extérieur avec des choses qui t’agressent en permanence. Tu essaies de trouver une raison à ta vie, tu essaies de justifier : pourquoi est-ce que je vis dans tant de pollution ? Pourquoi est-ce que je me galère à me mettre dans le métro avec dix mille personnes ? Pourquoi est-ce que je me galère à faire ci et ça ? On essaie tout le temps de trouver des justifications à ça. Dans ces situations, la religion m’a beaucoup aidé. Mais une fois qu’on est au milieu de la nature, dans les oliviers et qu’on voit la majesté de la vie - un autre mot pour désigner Dieu -, on se pose moins ces questions. Énormément de conflits intérieurs disparaissent et il y a une spiritualité naturelle qui prend une place en toi, sans avoir nécessairement besoin d’un dogme X ou Y qui t’explique le pourquoi du comment. Ce départ en Toscane, en pleine nature, m’a rendu plus spirituel et moins religieux.
Depuis que j’ai trouvé le paradis, j’ai moins besoin de croire en Dieu.Pour finir : c’est quoi ton métier, Jérôme ? C’est essayer d’être moi-même. C’est très compliqué, c’est un métier à plein temps. Dans ma vie, il y a deux questions qui m’ont toujours posé énormément de problèmes : “où est-ce que tu habites ?” et “qu’est-ce que tu fais dans la vie ?”. La première, je l’ai résolue. La deuxième me donne encore du mal. Le truc de base pour tout le monde, je n’arrive pas à y répondre. Maintenant, j’habite en Toscane.
Ça m’a pris 38 ans pour répondre à la première question. La deuxième, peut-être que je prendrai soixante-dix ans pour trouver ce que je fais dans ma vie.Au fait, avez-vous déjà lu notre portrait sur Valérie Atlan, la marraine du rap game ?