Stolen!, l'application qui fait péter un câble à Twitter
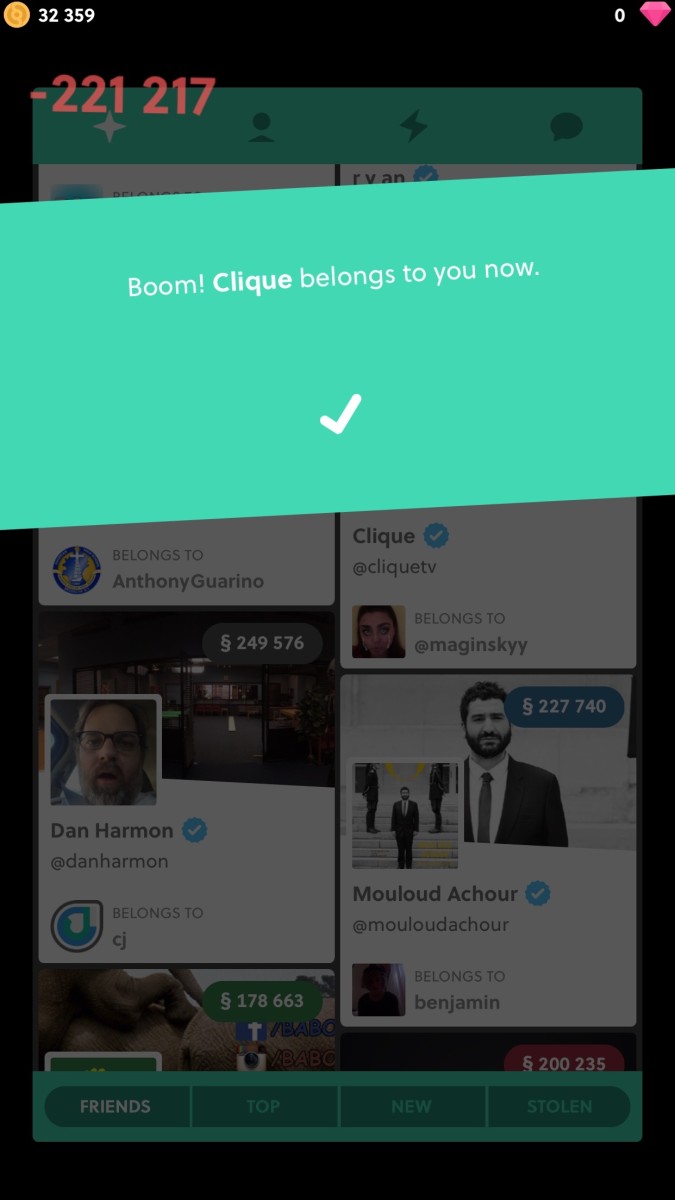
David Bowie est mort et il se trouve sûrement des jeunes gens nés après, disons, 1980 pour trouver qu’une fois de plus, leurs ainés en font des caisses autour d’une de leurs vaches sacrées générationnelles, au prétexte d’une demi douzaine de titres « gold » inlassablement ressassés par les robinets dédiés.
Une fois n’est pas coutume, pourtant, l’événement porte loin au delà de la musique, si magique soit-elle, et de la complaisance narcissique des post baby boomers pour tout ce qui renvoie à leur jeunesse sacralisée. Et si je ne suis, hélas, pas sûr d’être assez éloquent pour dire à plus jeune que moi l’empreinte laissée sur notre monde par ce gringalet rosbif à dentition foutraque et regard dépareillé, le moins que je doive au phare qui aura éclairé dix ans de ma vie de façon déterminante, c’est au moins d’essayer.
Certes, au départ, David Bowie, c’est de la musique rock. Et de ce point de vue « musical », il peut être argué qu’entre les disques qu’il aura publiés, ceux qu’il supervisa pour Lou Reed ou Iggy et ceux dont il aura pavé la voie ou allumé la mèche, les années 70 lui appartinrent. Comme, il peut être argué qu’il ne fut par la suite plus jamais aussi pertinent et urgent (comment, d’ailleurs, eut-il pu encore l’être après l’avoir tant été ? Demandez à Prince ce qu’il en pense).
Bref, de « Hunky Dory » en 1971 à 1980 avec « Scary Monsters », le trajet stylistique est juste vertigineux : rock, folk, glam, R&B, disco, indu, synthé, new wave, cold wave, no wave, électro, il aura tout exploré, tout amorcé, tout traversé — et nous derrière, courant après, chaque fois pris par surprise, chaque fois délicieusement brutalisés.
Pourtant, s’il ne s’agissait que de ça, onze albums en dix ans, ce serait triste, mais ma foi, ce serait juste une page d’histoire du rock qui se tourne et franchement, ces jours-ci, on a autre chose en tête.
Seulement voilà : comment à présent faire comprendre à qui n’a pas connu cette époque toutes les autres dimensions que pouvait prendre alors la possession d’un album de David Bowie. En suburbia américaine, dans un lotissement ouvrier du Yorkshire ou au plus arriéré de la province française, dans les années 70, n’importe lequel des albums de Bowie constituait un parachutage de vivres et de munitions — et, plus encore, d’élégance et de raffinement. S’immisçaient alors en contrebande dans des quotidiens ternes des promesses d’avant garde, des décadences rêvées, des ambigüités stimulantes. Dans maints foyers, lumpen Groseille ou peine-à-jouir Duquesnoy confondus, un album de Bowie pouvait s’avérer l’objet le plus esthétiquement abouti et le plus sophistiqué intellectuellement que l’on puisse y trouver. La présence d’un de ses disques dans la pièce en lézardaient les murs, ouvraient une brèche dans la chape imposée par l’école, les parents, l’ordre des choses et les déterminismes socioculturels afférents. L’introduction d’une pochette le représentant dans une chambre d’ado était celle d’un bienheureux virus qui dynamisait l’ensemble. Une lampe dont allait sortir son génie sur commande. À défaut d’exaucer trois vœux, il hisserait alors l’auditeur au dessus de sa condition en postulant un autre monde possible. Un monde dont, par le jeu de ses emprunts, allusions et détournements, il élargissait l’horizon. Grâce à lui, l’art, la culture, dont les institutions savaient si bien nous exclure et nous dégouter, n’étaient plus l’ennemi. Au contraire. C’étaient des armes, des outils à fourbir, c’étaient le tunnel par lequel nous allions nous évader du camp.
Après, c’est comme toujours avec l’omelette. Il y a du dommage induit. De même que le génie littéraire de Dylan ouvrit la route à toutes les incontinences folk et verbosités « à texte » endurées depuis, les fusions et fissions pratiquées par Bowie entre les codes du rock et des ingrédients « arty » ont libéré, davantage pour le pire que pour le meilleur, moult simagrées et impostures d’avant-gardistes mythos mal orientés à la fin de la 3ème.
Tant pis. Si c’est le prix à payer, il est franchement modique, confronté à ce que le monde lui doit concernant le décalaminage de nos mentalités.
Il nous aura « ouvert l’esprit ». A tous les égards, dans tous les domaines et tous les sens du terme.
L’art et, on va dire, c’est ça qui est bien, c’est politique. Le style, c’est de la morale. Tout au long des années 70, sur la foi de sa seule aura, David Bowie aura aboli autant de préjugés sexuels qu’il aura défriché de savanes esthétiques.
A force de coupes de douilles laisse tomber, de maquillages cherchez le garçon et d’accoutrements que lui seul pouvait risquer sans relever du freak show ou du cirque Pinder, il aura changé le jeu et relooké le stade. Syllogisme imparable : entre 70 et 80, quelque soit l’instant T, Bowie était ce qu’il y avait de plus hip, de plus classe et de plus cool dans le monde occidental. Or Bowie était ambigu. Bowie était androgyne. Bowie était bi. Bowie, plausiblement, prenait du rond où je pense et avalait des teubes. Du coup, mécaniquement, l’ambigüité, l’androgynie, la bisexualité étaient hip, classe et cool. Bowie l’exception venait à lui seul dézinguer la règle « homophobe ordinaire » qui prévalait alors.
Autrement dit, et nous en témoignons, pour ses beaux yeux vairon, un dadais blaireau tout ce qu’il y a de lampda, hétéro-beauf en devenir bien trop lent à son goût, sentait insidieusement son esprit s’enrichir, s’« élargir ». Bowie l’aidait à endurer l’ingratitude de son âge, la fadeur de son biotope. Au passage, un peu de tolérance affleurait, s’esquissait.
Qu’on imagine alors la question de vie ou de mort que chacun de ses disques ou concerts pouvaient représenter, le pont aérien vital qu’ils entretenaient, les effets proprement miraculeux qu’ils avaient sur un jeune homme plus incertain dans ses désirs et préférences ! La possibilité qu’il entrouvrait, le réconfort qu’il apportait, la main que pouvait saisir in extremis le garçon en question en entendant l’idole lui hurler rien qu’à lui « oh no, love, you’re not alone ». Surtout si, comme chaque jour, on s’était foutu de lui à l’école. Surtout s’il lui avait, comme chaque soir, fallu courir sur le chemin du retour pour échapper à une raclée. Une fois seul dans sa chambre, Bowie, son seul ami, le seul à vraiment le comprendre, venait en majesté lui apporter la communion : you’re not alone.
Comme ces jeunes gens d’alors devenus quinqua aujourd’hui doivent donc être endeuillés ! Mais, pour citer le défunt, et quand bien même le héros de leur jeunesse n’est plus, ils ne sont décidément pas seuls, puisque grâce à lui, le reste de la société (ou du moins une bonne part d’icelle) les a embrassés. Parfaitement, si ma génération de vieux mâles blancs hétéros beaufs a pu, en vieillissant, supporter puis soutenir l’avènement d’une culture LGBT, puis accompagner et célébrer la reconnaissance égalitaire d’autres préférences sexuelles et d’autres assignations de genres, c’est grâce à l’éveil des consciences initial amorcé en son temps par le règne de Bowie sur toute une décennie.
Une tolérance, c’est vertueux, ne vient jamais seule. Et peut en entrainer bien d’autres. Ainsi, quand on a eu cessé de ricaner sans raisons des pédés, on s’est aussi exercé à perdre le réflexe d’avoir peur des Arabes, et des Noirs, et des Femmes. Pour la génération de mes enfants, ces choses-là vont d’elles mêmes. Tout ça est normal. Après tout, c’est dans ces critères-là qu’ils ont été élevés. Et ils auront du mal à se représenter qu’il eut pu en être autrement sans un anglais malingre, Fregoli maniéré, cleptomane impudent et impénitent, roi de la cuisine d’assemblage de denrées braconnées chez le voisin, malin, madré, roué, dégourdi comme c’est pas permis, qui s’appelait David Jones et eut toutes les audaces sous le nom de Bowie.
Son impact sur son époque qui est aussi la nôtre ne saura être exprimé avec assez de solennité et de gratitude. Sans lui, notre monde serait encore plus bête, encore plus méchant. Sans lui, les mâles blancs de mon âge seraient encore plus cons, encore plus phallo et euro-centrés. Perspective qui fait peur, putain. C’est donc pour ça, jeunes gens, convainquez-vous en : tout ce raffut n’est pas volé. C’est un grand grand homme qui vient de mourir. Incidemment, il laisse quelques bons disques.