Fa-Schisme

Philippe Tabarly est un type plein d'humanité. Si son cousin Eric naviguait sur toutes les mers, Philippe explore avec un coup de caméra soigné tout ce qu'il ne connaît pas pour donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Détenus, allocataires du RSA, enfants de quartiers défavorisés, il veut filmer vrai, pour capter ce qu'il trouve de plus beau : le don de soi et la sincérité de chacun.
Qui es-tu ?
C’est une question essentielle et infinie. Je suis un homme de 65 ans. Ca correspond à l’âge de la retraite, « la nouvelle traite », je ne sais pas si je vais la prendre (rire).
J’ai découvert ma mère à cinq ans, ayant été élevé par mes grands-parents. Mes parents avaient divorcé, j’ai eu une adolescence compliquée. Ce n’était pas la guerre, mais il y avait un peu de Sarajevo chez moi quand même. Le monde ne me rassurait pas, donc j’ai fait tout un travail inconscient pour ne pas en faire partie, je me raccrochais aux « images » plus qu’à la réalité de la vie.
Je me suis raccroché au sport, j’étais bon au foot, on m’avait même proposé de passer semi-pro, mais je voulais surtout me tourner vers l’image. Avant de passer mon bac je suis parti en Angleterre puis aux États-Unis pour faire une école de cinéma; « The Germain School of Photography ». Pendant mes études cinématographiques, j’ai eu la chance de travailler sur le documentaire de deux grands documentaristes ; Chris Marker et François Reichenbach : « La sixième face du Pentagone ». Ce film relate la très grande manifestation organisée en octobre 1967 par la jeunesse américaine en opposition à la guerre du Viêt-Nam et nous avons été nombreux à avoir passé une nuit en taule, arrêtés par les US Marshall de l’époque…
Depuis que j’ai une réflexion indépendante, je ne veux pas arrêter d’être bouleversé. Je trouve des pistes, et pas les plus simples, pour continuer à être bouleversé. Être bouleversé, c’est être à l’écoute de ce qui n’est plus toi, une façon de mettre son « ego en veilleuse ». Dans ce bouleversement, il y a de la vie, il y a une place pour l’autre, c’est une éthique aussi inscrite dans mes films, une façon de travailler.
Tous ces décalages ont construit un enfant particulier, il a fallu remettre ces différents morceaux de moi à leur place. il a fallu que je remette mes différents morceaux à leur place. C’est pour ça que je n’ai commencé la réalisation qu’à 36 ans, une sorte de naissance pour moi. Avant, j’accompagnais les films comme cadreur, chef opérateur.
Comment es-tu arrivé au cinéma ?
Je suis « rentré » dans l’image, grâce à mon père. Je ne le voyais pas, il n’était jamais là. Après sa journée de travail à la SNCF comme électricien, il repartait au cinéma d’Arpajon, où il « faisait » le projectionniste. C’était plein de petits actes pour créer le silence avant la projection, des moments magiques ! C’était ça la vraie parenthèse de l’art qui s’ouvrait. Cet homme m’a amené à ça. J’ai écrit un texte pour lui, en hommage à la conscience que j’ai de lui et de ce qu’il m’a transmis.
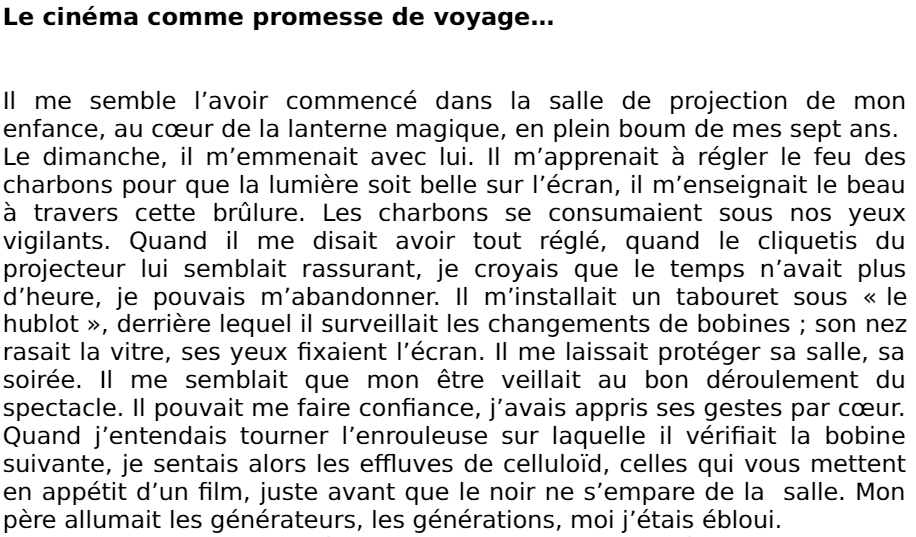 Texte de Philippe Tabarly (extrait).
Texte de Philippe Tabarly (extrait).
Il est venu me voir une seule fois sur un film. Il était très touché, on tournait à Paris et il me voyait organiser l’éclairage, je sentais qu’il était fier et heureux de me voir à ce poste. Quand j’étais enfant je le voyais peu, je luttais contre le sommeil pour l’entendre rentrer, parfois l’apercevoir. J’avais l’impression que le cinéma avait volé mon père, et c’est peut-être ça qui m’a conduit à venir au cinéma pour symboliquement le retrouver dans l’image qui fait sens…
Il y a de l’imaginaire dans l’image, elle peut « être dure », elle peut tout représenter cette image, elle m’affranchit, elle m’ouvre à la confrontation dans le réel, elle me fait naître à l’existence ; « nous naissons deux fois, une fois pour l’espèce, une fois pour l’existence », elle m’invite à mieux réaliser ma vie, c’est ainsi que je « rentre » dans la réalisation.
Quel est ton premier film ?
Pour devenir réalisateur, il faut s’autoriser à franchir un cap, ce n’est pas évident. Le premier film était une commande pour une marque de champagne. Ils ne m’ont même pas donné une seule bouteille d’ailleurs (rires) ! Une productrice m’a repéré. J’ai ensuite réalisé un court-métrage à partir du collectif Organum, des artistes qui faisaient des performances dans la rue, c’était plein de symboles, on était jeunes, on s’exprimait farouchement, voluptueusement, on s’éclatait.
A ce moment, Gérard Blain sortait en salle Pierre et Djemila, et mon court-métrage a été pris en première partie. D’ailleurs, tous les cinémas sont hors-la-loi aujourd’hui. La réglementation veut que les projections soient des « programmes constitués » de deux films, avec un court-métrage en première partie et le film de long-métrage en seconde partie. On a viré les courts-métrages pour mettre les pubs ! Tous les gens qui vont au cinéma pourraient envoyer leur place au CNC pour un remboursement ! A cause de ça, c’est devenu difficile pour les producteurs de faire des courts-métrages car ils ne sont plus diffusés. Heureusement Internet permet à des jeunes talents de s’exprimer comme l’Agence du court Métrage.
Plus tard, tu sors Le Coupeur d’eau, court-métrage de 24 minutes qui reçoit trois prix internationaux…
J’étais dans une période de ma vie où je me cherchais. Je revenais d’un grand voyage au Tibet en stop, en 1985, quand j’ai lu un texte extraordinaire de Marguerite Duras qui racontait l’histoire d’un fait divers d’une tuée sous un TGV à cause d’histoires de fric. C’est une histoire d’incommunicabilité basée sur un fait divers, où un couple décide de mourir avec toute la famille. J’ai commencé mon travail là où s’arrêtait celui des journalistes : j’ai inventé la dernière journée de la vie de cette famille.
En 1988, j’ai donc travaillé avec Duras pendant deux ou trois mois pour préparer le film. Elle me recevait chez elle. Elle était face à sa fenêtre, en pleine lumière, elle buvait un café sans jamais m’en offrir (rires), et nous parlions.

Marguerite Duras, ci-dessus
Quel souvenir gardes-tu d’elle ?
C’est un vrai monument, qui a fait de toutes ses blessures la réalité de ses romans. Ce n’est pas une imposture, ce qu’elle donne de puissamment singulier se transforme en universel, c’est une grande force. Elle a un rythme musical, un regard tellement intime. Et le cinéma est très proche de la musique, elle m’a ouvert des pistes de « maturité ».

Tu fais souvent références à des auteurs et philosophes. Certains t’inspirent ?
Je ne suis pas un grand lecteur. Le Coupeur d’eau, c’est le seul film que j’ai fait à partir d’un livre. Sinon, j’ai besoin d’inventer des personnages. Je fais peu de films, en fait, j’ai dû en faire 17 dans toute ma vie, dont deux fictions. Mais je m’aperçois que ce qui me pousse à travailler, c’est une manière de penser : réenchanter l’humanité à travers ce questionnement : « que faut-il abandonner pour aller mieux ? »
Et que doit-on abandonner, alors ?
Ce qui est connu. Quitter sa zone de confort. L’Autre est un voyage formidable, il ne faut pas le considérer comme un concurrent. Je crois en l’émulation ! Si on a peur du risque, il ne faut pas vivre. Vivre c’est accueillir ce qu’on ne connaît pas.
Je ne me rattache pas vraiment à un courant philosophique. Mais quand il y a un désir d’élévation, d’aller vers quelque chose de plus complexe que ce qu’on connaît, ça m’attire.
On ne peut pas faire de cinéma seulement pour divertir alors ?
Non. Ce serait possible si on avait deux chômeurs en France, mais ils sont des millions. S’en mettre plein les poches sans donner de message, c’est malhonnête. Il faut apporter des solutions. Il faut donner des outils aux gens pour qu’ils cultivent leur jardin. On ne produit pas de l’apaisement comme ça, juste avec du rire sans message.
Quels cinéastes t’inspirent le plus ?
J’ai beaucoup appris auprès de Robert Bresson, j’étais dans son équipe pour son dernier film, L’Argent, en 1981. Pialat et Fellini me manquent aussi. Denis Villeneuve m’inspire. J’aime les héros de Guédiguian, qui deviennent des modèles, même si je ne suis pas en phase avec tout ce qu’il fait. Les cinéastes français actuels ne m’inspirent pas beaucoup, je trouve qu’ils ne disent pas grand-chose. Pourquoi ne proposent-ils aucun message, avec la tribune qu’ils ont grâce à la célébrité ? On a aujourd’hui un flot de films qui veulent rentrer dans le marché. J’aime les films qui touchent à l’universel. Je ne retrouve pas souvent cette puissance aujourd’hui, à part quelques exceptions, comme dans Incendies. A la télé aussi, on est beaucoup dans le commercial. Les gens sont là pour vendre leurs produits, et les présentateurs disent qu’ils sont bons suivant le nombre d’exemplaires vendus. C’est vraiment très pauvre comme analyse et comme représentation de l’humain. Je veux un « cinéma vérité », un cinéma qui nous éloigne de nous même pour nous rapprocher d’autrui, qui fasse travailler en nous, ce qui nous ressemble très profondément. S’il n’y a pas ce niveau de réflexion, d’intention, le commerce nous guette…
 Robert Bresson ci-dessus
Robert Bresson ci-dessus
Tu as travaillé sur le milieu carcéral, avec deux films documentaires tournés à la prison des Baumettes à Marseille : On sortira tous un jour et Eh la famille ! Qu’est-ce que tu en as retenu ?
Je n’ai jamais été aussi libre pour tourner, paradoxalement ce fut en prison ! A Paris, je ramais sur un documentaire, je suis parti à Marseille pour répondre à un contrat, c’est ainsi que j’ai commencé une démarche de trois années pour un laboratoire cinématographique questionnant le langage, mon objet de recherche, « la place du spectateur »
J’ai filmé la manière dont les détenus se préparent à leur libération. Si tu trouves un boulot et un toit pour ta sortie, on va te libérer. Mais si le boulot et le toit sont merdiques, tu as de fortes chances de revenir en prison rapidement, et avec des peines encore plus lourdes ! 97% des gens en taule sont des pauvres. J’ai peu vu d’avocats là-bas ! (rires) La prison n’est pas une aide ni une solution. Et j’ai filmé la relation à la famille quand on en est coupé, la personne fantasme la famille, cela m’a pris une année et demi pour chaque film.
 ‘Eh la famille ! (2007)
‘Eh la famille ! (2007)
Mon rôle dans ces deux films était de transmettre ce que ressentaient, pensaient les détenus, vers l’extérieur, une fois la juste distance trouvée avec eux. Je n’aime pas ce terme « détenu » qui n’est qu’administratif, il y a des prisonniers qui ne sont pas des détenus. Ces films m’ont permis de trouver des formes cinématographiques et ma place. Et puis quand j’ai présenté le film au personnel de la prison, les détenus qui avaient joué, tourné, réalisaient qu’ils étaient allé au bout, que le film existait et ça leur donnait une très grande force, une réelle respectabilité, ce qui est loin de leurs valeurs. Ça a aussi changé momentanément leur rapport avec les gardiens, qui ont modifié leur regard.
Je reste en contact avec pas mal de ces détenus ou ex-détenus. J’aime la manière dont le pardon se fait à leur retour, c’est l’une des plus belles choses chez l’homme : au-delà du don, il y a le pardon.

Eh la famille ! (2007)
On critique souvent les conditions de vie des détenus dans les prisons françaises. C’est justifié ?
Oui. J’ai vu des cellules où même mon chien ne resterait pas. Les juges gagneraient à visiter les cellules où ils envoient les gens ! Même les écoles devraient y emmener les enfants pour qu’ils voient comment la république punit. Ce n’est pas parce qu’on punit les gens qu’il faut les priver de leur dignité.

Eh la famille ! (2007)
Tu as aussi fait un film sur le théâtre et les jeunes ?
Oui, il s’appelle Mardi on a théâtre : j’ai travaillé dans une maison de la culture au Mans, pendant un an, dans un quartier dit « sensible » – ce qui suppose qu’il y aurait des quartiers « insensibles » ! J’ai accompagné une classe de jeunes qui suivaient pour la première fois de leur vie un cours de théâtre, et j’ai filmé leur « transformation », ce qui s’accomplissait en eux. Ils sont tous passés en classe supérieure, ils sont tous devenus des petits mômes beaucoup plus « habités », plus « centrés », ce fut un beau parcours à vivre ensemble.
Qu’est-ce qui te pousse à filmer ces personnes ?
Je crois que j’ai envie de comprendre les limites indispensables à créer pour vivre ensemble, savoir où j’en suis aussi. J’avais trois ans, mes grands-parents m’ont présenté une fleur qui ne fleurit qu’une fois par an, ils l’appelaient « le sourire de belle-mère » (rires). On est de passage, l’ultime limite, c’est la mort, c’est une conscience libératrice, pas développée dans notre civilisation occidentale.
Je n’ai jamais été dans le confort, dépenser une énergie pour rester dans le connu. Ce n’est pas facile, mais ça me rend libre. J’ai beaucoup de mal à trouver des financements pour mon film de fiction actuel, je n’entretiens pas vraiment de réseaux. C’est devenu difficile de faire certains films.
C’est une situation que tu vis mal ?
Non. Ce n’est pas pratique, j’ai toujours mes idées de films. Ca me libère d’écrire des scènes, de créer des personnages, d’être dans cette action. Cette difficulté à rentrer en production m’invite à me ressourcer en famille, avec mes enfants et petits-enfants. Il y a malheureusement des pays où l’on vit plus mal, restons vigilants et surtout désirants.
Quels sont tes projets ?
J’en ai cinq, dont trois fictions. L’une d’entre elle est un thriller en apparence, de nouveau autour de la prison, avec une juge victime d’un complot. Elle se retrouve dans une cellule avec une braqueuse, c’est la naissance d’une amitié étonnante entre ces deux femmes.
J’ai aussi un projet pour la télé ou le cinéma, sur des personnes incarcérées qui vont s’interroger pendant trois mois sur leur rapport à l’argent, interdit dans l’univers carcéral, avec un psychopathologue, dans un endroit de la prison spécialement aménagé pour le film, une première en France.
Es-tu heureux ?
Je suis en colère, car ce monde est abîmé par très peu de gens. C’est une colère pour une invitation à vivre ensemble dans une simplicité, le bonheur ne ment pas, comme le corps, encore faut-il savoir l’écouter. Je partage de beaux moments avec mes enfants et mes petits-enfants, d’une puissante simplicité. C’est une réelle source dans mon désir de filmer, car « il n’y a d’image que là ou l’autre existe » pour citer le formidable critique Serge Daney.

Noël en prison. Eh la famille ! (2007)
Mise à jour : 8 mai / 18h40